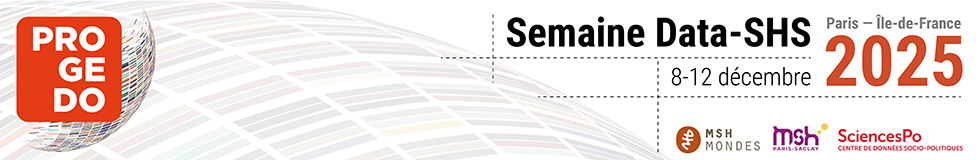Les sessions se dérouleront à l’Université Paris Nanterre (bâtiment Max-Weber), à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Centre Panthéon et Maison des sciences économiques), à l’ENS Paris-Saclay et au Campus Condorcet (Auditorium).
Lundi 8 décembre
Session d’ouverture [11h00 - 12h00] - Conférence nationale
Actualité des infrastructures de recherche Progedo et Huma-Num
En visio-conférence uniquement
- Nicolas Sauger (Directeur de l’IR* Progedo)
- Olivier Baude (Directeur de l’IR* Huma-Num)
Cette séance commune aux deux infrastructures de recherche étoile (IR*) en sciences humaines et sociales a pour objectif d’exposer les actualités respectives d’une manière conjointe. La mission principale de l’infrastructure de recherche Huma-Num est de mettre en œuvre une infrastructure numérique permettant aux communautés SHS de développer, de réaliser et de préserver sur le long terme les programmes de recherche. Quant à l’infrastructure de recherche Progedo, elle a pour but de développer la culture des données quantitatives, d’impulser et structurer une politique des données d’enquêtes pour la recherche en SHS.
Session no 1 [13h30 - 17h00]
Enquêter sur la parenté en sciences sociales
Université Paris Nanterre, bâtiment Max-Weber, salle de conférence
200 avenue de la République, 92000 Nanterre, et en visio-conférence
Discutant·e·s : Yann Bruna (Sophiapol, Université Paris Nanterre), Maroussia Ferry (Centre Maurice Halbwachs, ENS)
Modération : Brian Chauvel (PUDN, MSH Mondes, UPN)
13h30 - Accueil café
13h50 - Heuristique d’une collecte de données de parenté pour l’ouverture d’un terrain au long cours - Lydia Zeghmar (LaSPP, Labex SMS)
14h20 - La qualité des données démographiques sur les liens de parenté dans des populations à système de parenté classificatoire - Aurélien Dasré (Cresppa, Université Paris Nanterre)
14h50 - Enquêtes ethnographiques de parenté : du terrain au corpus codé, exemples d’Afrique de l’Ouest et d’Amazonie - Isabelle Daillant (EREA-LESC, CNRS), Olivier Kyburz (LESC, Université Paris Nanterre)
15h30 - Pause café
15h50 - Confrontation de sources et reconstitution de généalogies à partir de fiches de famille (enquête Louis Henry, projet ANR Daicretdhi) - Arnaud Bringé (Ined)
16h20 - Enquêter des populations difficiles à atteindre : la méthode d’échantillonnage « Network Sampling with Memory » appliquée dans l’enquête Immigrés chinois à Paris et en région parisienne (ChIPRe) - Géraldine Charrance (Ined), Aurélie Santos (Ined)
Mardi 9 décembre
Session no 2 [9h00 - 12h30]
Éthique de la vulnérabilité, vulnérabilité de l’éthique
Université Paris Nanterre, bâtiment Max-Weber, salle de conférence
200 avenue de la République, 92000 Nanterre, et en visio-conférence
Modération : Cyrille Bouvet (ClipsyD, Université Paris Nanterre)
9h00 - Accueil café
9h30 - Enquêter par questionnaire auprès d’adolescents et leurs parents : choix de la méthode de recueil de données et précautions éthiques - Geneviève Bergonnier Dupuy (CREF, Université Paris Nanterre), Virginie Avezou (CREF, Université Paris Nanterre)
10h45 - Regards pluriels sur la notion de vulnérabilité dans la recherche - Anne Lacheret (Modyco, Université Paris Nanterre), Alexandre Coutté (Licaé, Université Paris Nanterre)
11h45 - Retour d’enquête sur les besoins éthiques des doctorant·es
12h30 - Pause déjeuner
Permanence [15h00 - 18h00]
Publier ses données de recherche
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Panthéon, salle 216
12 place du Panthéon, 75005 Paris
Accompagnement au dépôt de données quantitatives et qualitatives par les membres de cinq services d’appui à la recherche :
- Expertise Numérique et Science Ouverte (ENSO) - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- Atelier de la Donnée de Nanterre (ADN) - Université Paris Nanterre
- Atelier de la Donnée de la Sorbonne (CoDataSorb) - Sorbonne Alliance
- Centre de données Socio-Politique (CDSP) - Sciences Po
- Plateforme universitaire de données Paris-Saclay - MSH Paris-Saclay
Mercredi 10 décembre
Session no 3 [9h00 - 13h00]
Avancées récentes de l’usage des méthodes d’IA en SHS
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Maison des sciences économiques, salle de conférence, 6e étage
106-112 boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris, et en visio-conférence
Modération : Lisa Chauvet (Professeure d’économie, Directrice adjointe du Centre d’économie de la Sorbonne)
9h00 - Accueil café
9h30 - Ouverture de la journée
- Ghislaine Glasson Deschaumes (Directrice de la MSH Mondes)
- Jean-François Caulier (Vice-Président numérique de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
- Sophie Hou (Vice-Présidente Science ouverte de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
9h45 - Présentation des projets portés par les services d’appui à la recherche
- Intégrer les grands modèles de langues à la boîte à outils du chercheur en sciences sociales - Joachim Dornbusch (CASIINR, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
- Intelligence artificielle et édition structurée : présentation d’une preuve de concept autour de la revue Gallia - Archéologie des Gaules - Valentin Chabaux (MSH Mondes), Nicolas Coquet (MSH Mondes)
- Améliorer l’exploration et l’accessibilité des données de la recherche en SHS. Attribution automatisée de concepts dans des référentiels de données de recherche. Projet européen ONTOLISST [EN ANGLAIS] - Barbara Babolcsay (POLTEX LAB), Alina Danciu (CDSP, Sciences Po), Chloé Hertrich (CDSP, Sciences Po)
11h15 - Pause café
11h30 - Présentation de projets de recherche
- Identifier les normes de genre dans les accords d’entreprise. Une expérience de lecture humaine augmentée - Anne-Sophie Bruno (CHS, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
- Cybermenaces, données et intelligence artificielle dans une perspective SHS : présentation du projet CYBERIA - Daniel Ventre (CESDIP, CNRS, Université Paris-Saclay)
Session no 4 [14h00 - 17h00]
Où et comment trouver des données en sciences sociales ?
Des ressources et plateformes françaises de confiance pour la recherche
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Maison des sciences économiques, salle de conférence, 6e étage
106-112 boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris, et en visio-conférence
14h00 - Introduction au paysage de la statistique publique - Brian Chauvel (PUD, MSH Mondes, UPN), Adèle Etaix (PUDN, MSH Mondes, UP1)
14h30 - Retour d’expérience sur l’utilisation des données confidentielles via le CASD - Alex Amiotte Suchet (IDHE.S, ENS Paris-Saclay), Eya Sahraoui (PUD, MSH Paris-Saclay)
15h00 - Pause café
15h15 - Trouver des données d’enquête dans le catalogue de données Quetelet-Progedo - Brian Chauvel (PUD, MSH Mondes, UPN), Adèle Etaix (PUDN, MSH Mondes, UP1)
15h45 - ReQuest : découvrir, comparer et réutiliser les données d’enquêtes par questionnaires de la Banque de données du CDSP - Lucie Marie (CDSP, Sciences Po)
16h15 - L’outil DataV et ses usages dans la recherche et l’enseignement - Selma Bendjaballah (CDSP, Sciences Po)
Jeudi 11 décembre
Les sessions de cette journée se déroulent parallèlement sur deux sites : le Campus Condorcet (Aubervilliers) et l'ENS Paris-Saclay (Gif-sur-Yvette)
Site 1 - Campus Condorcet
Session no 5-1 [9h00 - 12h00]
Données localisées en SHS
Campus Condorcet, Humathèque, Auditorium
10 cours des Humanités, 93300 Aubervilliers, et en visio-conférence
9h00 - Accueil café
9h30 - Introduction de la journée - Clément Oury (directeur général adjoint du Campus Condorcet en charge de l’Humathèque)
9h50 - Chercher des données géographiques et se former à leur manipulation - Robin Cura (Prodig, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Hugues Pécout (Géographie-cités, CNRS)
10h30 - Pause café
11h00 - Unité géographique et pseudonymisation dans le catalogue de Quetelet-Progedo : quelles références ? Les trouver et y accéder - Julie Baron (Ined, SES), Frédérique Gros (IR* Progedo, CNRS)
11h30 - « France Contexte Local 1975+ » : une base contextuelle d’indicateurs calculés à partir du recensement de la population et d’autres sources administratives, à un niveau géographique fin depuis 1975 - Giulia Ferrari (Ined, SMTD), Oumar Sarr (Ined)
12h - Pause déjeuner
Session no 5-2 [13h30 - 15h00]
Données localisées en SHS
Campus Condorcet, Humathèque, Auditorium
10 cours des Humanités, 93300 Aubervilliers, et en visio-conférence
13h30 - Apprendre et enseigner la cartographie thématique avec Magrit - Timothée Giraud (RIATE, CNRS), Matthieu Viry (RIATE, CNRS)
14h00 - Représenter et interpréter des indicateurs de mobilité géographique avec Magrit - Maxime Guinepain (CESAER, INRAE)
14h15 - Le Mobiliscope : un outil libre de géovisualisation des populations présentes dans les territoires au cours de la journée - Julie Vallée (LISST, CNRS)
14h45 - Pause café
Atelier [15h30 - 17h30]
« Faire une carte »
Campus Condorcet, Humathèque, salle 1.06
10 cours des Humanités, 93300 Aubervilliers
> NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Les inscrit·es doivent transmettre leurs objectifs et un exemple de données aux organisateur·trices deux semaines avant l’atelier.
Les ateliers-garage "Données localisées" de Mate Condorcet pourraient aussi vous intéresser (les 8/12, 15/01 et 22/01) : infos et inscription.
Aide à la préparation des données
Élodie Baril (Ined, SMTD), Bénédicte Garnier (Ined, SMTD et Mate-SHS Condorcet), Alexandre Wauthier (Mate Condorcet, Humathèque), Brian Chauvel (PUDN, MSH Mondes, UPN), Adèle Etaix (PUDN, MSH Mondes, UP1)
Géographes, cartographes, géomaticiens
Timothée Giraud (RIATE, CNRS), Matthieu Viry (RIATE, CNRS), Maxime Guinepain (CESAER, INRAE), Benoît Pandolfi (CASIINR, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Émile Blettery (CASIINR, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Brian Plaisant (Géotéca, Université Paris Cité)
Site 2 - ENS Paris-Saclay
Session no 6 [10h00 - 12h00]
Petits Déjeuners Durkheim (3)
ENS Paris-Saclay, Bibliothèque Durkheim, Bâtiment ouest, 3e étage
8 avenue des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette, et en visio-conférence
Inscriptions prochaines sur msh-paris-saclay.fr
Modération : Eya Sahraoui (PUD, MSH Paris-Saclay), Elsa Bansard (MSH Paris-Saclay, Université Paris-Saclay)
Discutant : Baptiste Coulmont (ISP, ENS Paris-Saclay)
10h00 - Mesurer la "droitisation" des classes moyennes supérieures, présentation et discussion de l’ouvrage Le triomphe des égoïsmes à paraître en janvier 2026 - Camille Peugny (Printemps, UVSQ)
Session no 7 [13h00 - 14h30]
Séminaire Quantitativisme Réflexif
ENS Paris-Saclay, salle 3e34
8 avenue des Sciences, 91190 Gif-sur-Yvette
Voir aussi le programme du séminaire
13h00 - Tableaux et graphiques pour une enquête sur la sexualité - Arno Muller (SMTD, Ined)
Vendredi 12 décembre
Session no 8 [14h00 - 17h00]
Framing Workshop “Visual Ecology & Archives”
Université Paris Nanterre, bâtiment Max-Weber, salle de conférence
200 avenue de la République, 92000 Nanterre, et en visio-conférence
14h00 - The pictorIA consortium - Fantin Le Ber (MSH Mondes), Julien Schuh (MSH Mondes)
AI and visual culture The Huma-Num consortium pictorIA brings together researchers and heritage institutions to develop shared tools, datasets, and critical approaches for applying artificial intelligence to the analysis and preservation of visual culture. Fantin Le Ber, research engineer within the pictorIA consortium, and Julien Schuh, professor at Université Paris Nanterre and deputy director of the MSH Mondes.
14h25 - Revisiting Networked Climate Images in a Changed Visual Ecology - Pr. Birgit Schneider (University of Potsdam), Dr. Paul Heinicker (University of Potsdam)
A retrospective and recontextualisation of the project "Analysing Networked Climate Images", tracking shifts in climate discourse, algorithmic infrastructures, and emergent challenges for visual methods. Paul Heinicker is a design researcher at the University of Applied Sciences Potsdam, focusing on the culture and politics of data-influenced images. Birgit Schneider is professor for Knowledge Cultures and Media Environments in the Department of European Media Studies at the University of Potsdam, Germany, focusing on scientific images, the history and present-day status of data visualizations and especially climate visualizations at the intersection of science, aesthetic and politics. She publishes in the fields of climate discourse, cultural geography, media studies and environmental humanities.
14h50 - Building a participative digital humanities network: The Potsdam example - Dr Luca Giovannini (University of Potsdam)
The talk recounts the experience of building a community-driven digital humanities network at the University of Potsdam, with a particular emphasis on its flagship project DraCor (dracor.org) and on the DH hackathon series. Dr Luca Giovannini works as research coordinator for the Digital Humanities Network at the University of Potsdam, Germany. His research interests focus on computational literary studies and cultural analytics.
15h30 - Pause café
15h50 - Gallica Images - Using digital innovation and AI to preserve national heritage - Danaë di Salvo (BnF)
Gallica Images is a French program that deploys artificial-intelligence pipelines to unlock, enrich and sustain one of Europe’s largest complex-image databases, high-resolution scans of manuscripts, maps, posters, photographs and periodicals held by the Bibliothèque nationale de France. By combining computer vision, deep-learning segmentation and multilingual OCR, the project automatically generates rich metadata, searchable captions and semantic links, turning static pixels into living, findable knowledge while guaranteeing long-term preservation and open, rights-cleared reuse for researchers, educators and creators worldwide. Danaë di Salvo is Project Manager, Lead UX @ Gallica images.
16h15 - Understanding the emergence of agricultural chemistry in France in the mid-19th century through quantitative data analysis - Julie Sohier (Master Histoire, Université Paris Nanterre)
The agricultural press of the period, together with the methodology developed within the ISOCO project, makes it possible to frame the debates that took place in the 19th century around the development of chemical fertilizers, to identify the key actors, and to map their positions within contemporary scholarly controversies. This approach consists in building a usable corpus from scattered historical documents already digitized online (Gallica, RetroNews) and, through textual processing with the IRaMuTeQ software, providing transversal, readable, and shareable access to a very large volume of data. Julie Sohier is a graduate of AgroParisTech and École des Ponts ParisTech, has completed continuing education at the UFR SSA, and holds a Master’s degree in Research in History and Social Sciences of Politics under the supervision of Patrice Baubeau and Laurent Herment, within the IDHE.S laboratory. She is Executive Director of POLLINIS (pollinis.org).
---
The EcoMedia project, developed within the framework of the EDUC European Alliance, aims to study how European societies, from the nineteenth century to the present day, have represented, debated, and imagined nature and the environment through various visual and textual media.
Two main research axes structure this project: first, ecological imaginaries, i.e., the narratives and images that shape our perception of nature; and second, media ecology, i.e., the analysis of technical media supports (illustrated press, photography, posters, digital media, etc.) and their influence on how the environmental crisis is perceived.
The first axis seeks to understand how representations of nature and the environment in culture (whether in literature, the visual arts, or the media) have constructed our relationship to the natural world. Ecocriticism, a discipline that emerged within literary and cultural studies, demonstrates that artistic and narrative constructions of “nature” at each historical moment deeply shape contemporary perceptions of the environment (Glotfelty and Fromm 1996; Garrard 2014). In other words, it is a matter of examining how nature was staged and what vision of the human–nature relationship resulted. In the nineteenth century, the popular illustrated press abounded with images of landscapes, natural phenomena, and colonial adventures in the wilderness; these descriptions of the environment fueled the Victorian public imagination and offer insight into the evolution of collective environmental sensibilities (Parkins and Adkins 2018). Likewise, in the contemporary era, the climate crisis is largely apprehended via images (“Écologies visuelles” 2023). In this sense, studying visual and textual narratives of nature helps us understand how the ecological imaginary has been constructed and how it influences our reactions to the current crisis (Schneider and Nocke 2014; Schneider et al. 2023)./p>
The second axis, media ecology, invites us to consider media themselves as environments. Each technical medium, from the nineteenth-century wood engraving to twenty-first-century social media, constitutes a particular ecosystem with its own codes, temporality, and audience, conditioning the circulation and impact of images (Castro et al. 2024). The history of environmental representations is therefore inseparable from the material history of media. The mediological hypothesis of the project is that technical evolutions (illustrated press, photography, television, internet, etc.) have altered the ways the environment is represented, and consequently, the ways the public becomes aware of it. Media logics shape both the content and the reception of environmental images (Mooseder et al. 2023).